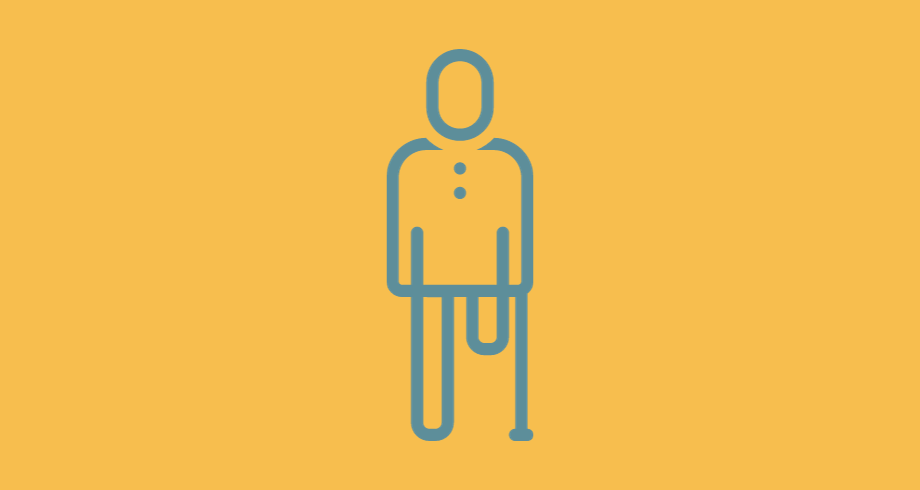
Un employeur peut-il engager ses recherches de reclassement sans attendre les précisions demandées au médecin du travail ?
oui ! …


La Cour de cassation réitère, dans son dernier rapport annuel, plusieurs propositions de réforme qu’elle avait émises, l’année dernière, en matière de droit du travail. Pas de suggestion inédite à signaler.
Comme chaque année depuis 2010, la Cour de cassation suggère de modifier l’article L452-3 du Code de la Sécurité sociale, propre à l’indemnisation des victimes d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Pour rappel, la faute inexcusable constitue une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire et caractérisée par deux critères principaux :
Selon la Haute juridiction, cette disposition, telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel, ne permet pas une indemnisation intégrale des victimes.
Aussi, elle propose son abrogation et son remplacement par une formulation « sans ambiguïté » précisant notamment que :
« [indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit] la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de Sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui ne sont pas indemnisés pour l’intégralité de leur montant par les prestations, majorations et indemnités prévues (…) ».
Le rapport rappelle néanmoins, une nouvelle fois, que la Direction de la sécurité sociale (DSS) est défavorable à cette évolution. Cette dernière estime notamment que la jurisprudence permet d’ores et déjà aux victimes de sinistres d’origine professionnelle d’obtenir un niveau élevé de réparation. Par ailleurs, la DSS considère que cette proposition entraînerait une suppression de la distinction entre la réparation de la faute inexcusable et celle de la faute intentionnelle, ainsi que des risques financiers trop importants pour l’équilibre de la branche.
Dans la suite de son rapport, la Cour de cassation renouvelle une proposition de réforme qui, l’année dernière, figurait parmi les suggestions inédites.
Celle-ci porte précisément sur la possibilité, pour les conseillers prud’homaux saisis d’une contestation sur un acte du médecin du travail (avis, proposition, conclusions écrites, etc.), de confier une mesure d’instruction à un médecin autre que le médecin inspecteur du travail.
Pour rappel, le Code du travail prévoit que la juridiction prud’homale doit recourir :
Seulement, comme l’indique la Cour de cassation, la loi manque d’exhaustivité et n’envisage pas l’hypothèse où aucun autre médecin inspecteur du travail ne serait pas, ou ne se rendrait pas disponible. Actuellement, on dénombre 22 médecins inspecteurs du travail en poste.
Dans un arrêt rendu le 22 mai 2024, elle avait toutefois admis que la juridiction prud’homale pouvait désigner un médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel à condition que celui-ci dispose d’une qualification en médecine du travail. Sa présence dans la rubrique « médecine du travail » n’étant pas pour autant exigée.
De leur côté, la Direction des affaires civiles et du sceau (DACS) et la Direction générale du travail (DGT) considèrent qu’en vertu du droit commun de l’expertise, les conseils de prud’hommes ont la possibilité de désigner tout expert inscrit sur les listes tenues par les cours d’appel de médecins experts et qualifiés en médecine du travail. En 2024, on en dénombrait 39.
Cette année encore, la chambre sociale appelle donc le législateur à s’emparer de cette question afin d’encourager et de promouvoir la mise à contribution de ces médecins experts.
La partie législative du code du travail comprend une sous-section spécifique consacrée à l’allaitement, qui compte quatre articles, complétés par plusieurs dispositions réglementaires :
Ces articles sont issus d’une loi adoptée le 5 août 1917. Ils n’ont pas été modifiés depuis.
Ce sont notamment les articles L1225-32 et R4152-13 à R4152-28 du code du travail qui posent des difficultés d’application.
D’une part, ces articles laissent entière la question des modalités de l’allaitement en direct d’un enfant sur le lieu de travail, s’agissant des entreprises employant moins de cent salariées.
D’autre part, dans les entreprises employant plus de cent salariées, c’est une véritable crèche d’entreprise qui est décrite par les articles R4152-13 et suivants du code du travail (l’employeur doit fournir un berceau pour chaque enfant, le local ne peut pas contenir plus de douze enfants, l’employeur doit fournir du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés aussi souvent que nécessaire ; en prévoyant que « personne ne doit passer la nuit dans le local dédié à l’allaitement où les enfants passent la journée », l’article R4152-26 présuppose que les enfants pourraient séjourner dans ce local). Mais ces dispositions comportent une contradiction.
Ainsi, l’article R4152-15 du code du travail dispose que les enfants ne peuvent séjourner dans le local destiné à l’allaitement que le temps de celui-ci.
La chambre sociale suggère donc l’abrogation des articles L1225-32 et R4152- 13 à R4152-28 du code du travail et l’adoption de dispositions réglementaires visant à mettre en œuvre l’article L1225-31 du code du travail, permettant aux femmes qui le souhaitent de pouvoir allaiter leur enfant dans un local ou de tirer leur lait.
La chambre sociale suggère également de profiter de la révision de ces articles pour assurer la conformité du droit français à la Charte sociale européenne. En effet, si le droit à une pause pour allaiter est bien reconnu par l’article L1225-30 du code du travail, conformément à l’article 8, § 3, de la Charte, cette pause n’est pas rémunérée.
Or selon le Comité européen des droits sociaux, « les pauses d’allaitement doivent en principe intervenir pendant le temps de travail et, par conséquent, être considérées comme des heures de travail et rémunérées comme telles ».
La direction générale du travail (DGT) indique que le droit du travail prévoit des dispositions particulières afin de favoriser la conciliation de l’allaitement et de la poursuite de l’activité professionnelle mais n’assimile pas ces pauses à du temps de travail effectif qui donnerait lieu à rémunération. Ainsi, l’article L1225-30 du code du travail prévoit que : « Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d’une heure par jour durant les heures de travail. »
L’article R1225-5 précise que cette heure est « répartie en deux périodes de trente minutes, l’une pendant le travail du matin, l’autre pendant l’après-midi ». Ce temps associé à l’allaitement ne constitue pas au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail du temps de travail effectif.
La DGT, saisie par la DACS, prend bonne note de cette proposition qui, pouvant avoir des impacts organisationnels et financiers conséquents pour les entreprises, ne pourrait être envisagée sans une concertation préalable avec les partenaires sociaux.
Concernant la recommandation visant à revoir les dispositions législatives et réglementaires abordant le sujet d’un local dédié à l’allaitement pour les ajuster et envisager leurs modalités d’application aux entreprises de moins de cent salariées, la DGT considère qu’au-delà de l’obligation légale de permettre l’allaitement dans les locaux de toute entreprise, les modalités ne peuvent appartenir qu’à chaque entreprise ou tout du moins à chaque secteur selon son organisation et ses lieux de travail. Cette souplesse et ces spécificités ne peuvent être connues et prises en compte que par des négociations d’entreprise ou de branche. La DGT prend donc bonne note de cette proposition, qui ne pourrait être envisagée sans une concertation préalable avec les partenaires sociaux.
L’article L423-24 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L423-25. L’inobservation de ce préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice du congé dû. Le particulier employeur qui ne peut plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l’agrément de celui-ci, tels qu’ils sont prévus par les dispositions de l’article L. 421-6, doit notifier à l’intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l’agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur. »
De son côté, l’article L423-2, 4o, du code de l’action sociale et des familles énonce :
« Sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives : […] 4o Au contrat de travail à durée déterminée, prévues par le titre IV du livre II de la première partie ».
Le premier texte est rédigé de telle manière qu’il paraît instituer au profit du particulier employeur un droit de ne plus confier son enfant à l’assistant maternel qu’il employait (droit de retrait par conséquent) tandis que le second texte soumet les assistants maternels à l’ensemble des dispositions du code du travail applicables au contrat à durée déterminée, et partant, à celles applicables à la rupture (anticipée) du contrat à durée déterminée selon lesquelles, « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail »[1].
La chambre sociale de la Cour de cassation a dépassé la contradiction entre les deux textes par application de la règle selon laquelle les lois spéciales dérogent aux lois générales en considérant que l’article L423-24 du code de l’action sociale et des familles constituait une règle spéciale, dérogeant à la règle générale posée à l’article L423-2, 4o, du même code, mais la solution n’est guère évidente.
Depuis 2014, la Cour de cassation suggère qu’une modification législative règle cette contradiction formelle entre les textes. À ce jour la contradiction persiste.
La DGT indique que cette proposition se justifie par le fait que si l’article L1243-1 du code du travail était strictement appliqué, il remettrait en cause le mode de rupture du « retrait de l’enfant » prévu dans le code de l’action sociale et des familles. Ainsi, sans l’intervention d’une faute grave, le parent employeur ne pourrait pas rompre le contrat à durée déterminée de l’assistante maternelle. Or, l’objectif de permettre de rompre le contrat en cas de « retrait de l’enfant » est justement de permettre de mettre fin à l’accueil sans nécessité d’un autre motif.
En pratique, ne pas appliquer les dispositions du code du travail traitant de la rupture anticipée du CDD ne permet pas à l’assistante maternelle d’avoir droit à une indemnité correspondant à la rémunération qu’elle aurait perçue si le CDD avait été exécuté jusqu’au terme initialement prévu.
Par conséquent, la DGT n’est pas opposée à la proposition de modification émise par la Cour de cassation dès lors qu’un vecteur législatif permettrait de la mettre en œuvre
Un certain nombre de salariés bénéficient, en raison d’attributions particulières, d’un statut protecteur, en vertu duquel leur licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail : salariés énumérés par l’article L2411-1 du code du travail.
La décision de l’inspecteur du travail, notamment la décision d’autorisation, peut être contestée devant la juridiction administrative, et les textes prévoient précisément les conséquences de l’annulation d’une décision d’autorisation en distinguant selon que le salarié demande ou ne demande pas sa réintégration dans les conditions prévues.
En revanche, la loi n’a pas envisagé l’hypothèse où un licenciement est prononcé par l’employeur en méconnaissance du statut protecteur, c’est-à-dire sans qu’une autorisation ait été sollicitée de l’inspecteur du travail.
C’est donc la jurisprudence qui a été conduite à déterminer les conséquences, notamment indemnitaires, de la violation par l’employeur du statut protecteur, non sans quelque hésitation en raison de la diversité des situations au regard de la durée de protection légale que la chambre sociale de la Cour de cassation a prise pour référence de la détermination de la sanction indemnitaire au profit du salarié protégé licencié sans autorisation qui ne demande pas sa réintégration.
La cour de cassation souhaite qu’elle ait un fondement légal. À ce jour aucune modification en ce sens n’est intervenue. La proposition est maintenue.
Consulter le rapport annuel 2024 de la cour de cassation : https://urls.fr/Xefc3Y