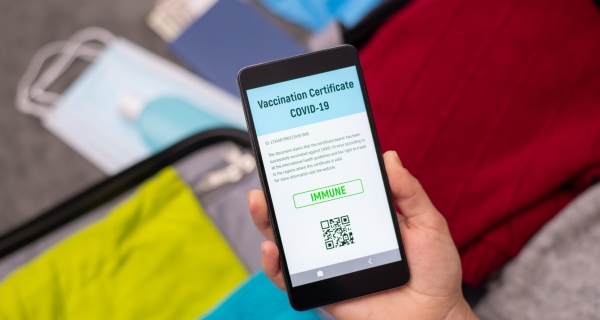
Obligation vaccinale et pass sanitaire
Le projet de loi « Relatif à la gestion de la crise sanitaire » prévoit notamment la vaccination obligatoire de certains professionnels

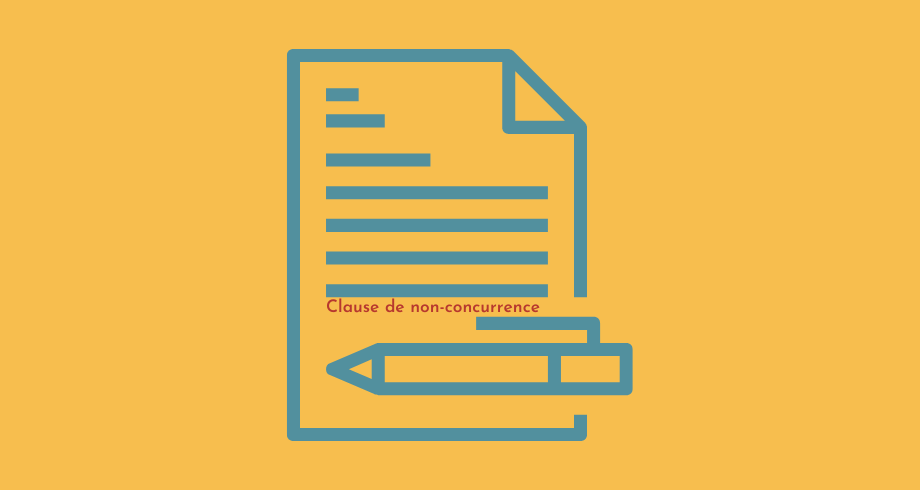
Afin de prévenir des atteintes aux intérêts légitimes de son entreprise, l’employeur peut prévoir, sous certaines conditions, une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de ses salariés
Selon la jurisprudence, une clause de non-concurrence est une clause par laquelle un salarié s’engage, après la rupture de son contrat de travail, à ne pas exercer une activité professionnelle concurrente susceptible de porter atteinte aux intérêts de son ancien employeur. Il faut noter que le nom de la clause dans le contrat de travail n’a aucun impact, en cas de conflit, les juges détermineront la classification de la clause par son objectif.
La clause de non-concurrence n’est pas légalement définie mais a été précisée et encadrée par la jurisprudence. Seul l’article L1121-1 du code du travail prévoit que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
Ainsi, cette clause, pour être valide et opposable, doit remplir plusieurs conditions cumulatives, fixées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment dans l’arrêt de principe de la Cour de cassation[1]qui indique que « une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives »
En effet, pour être valable, la clause de non-concurrence doit respecter les 5 critères suivants :
Les conditions doivent être réunis cumulativement pour que la clause de non-concurrence soit licite. Ils sont soumis, en cas de contestation, à l’appréciation souveraine des juges. Si ces critères ne sont pas réunis, la clause est nulle et ouvre droit à des dommages et intérêts pour le salarié.
À titre d’illustration, la jurisprudence considère comme illicite :
La clause de non-concurrence s’applique soit à la date effective de la fin de contrat (à l’issue du préavis), soit lors du départ du salarié en cas de dispense de préavis.
Lorsqu’il souhaite la mettre en application, l’employeur doit verser au salarié la contrepartie prévue. Cette contrepartie ou l’indemnité compensatrice prévue doit être versée par l’employeur à la fin du contrat de travail ou lors de sa rupture. Ainsi, la contrepartie ne peut pas être versée pendant l’exécution du contrat de travail mais uniquement lorsqu’il est rompu ou prend fin. Dès lors le salarié sera tenu de respecter cet engagement. A défaut, l’employeur peut interrompre le versement de la contrepartie ou engager une procédure à l’encontre du salarié pour demander des dommages et intérêts.
L’employeur a la possibilité de renoncer à l’application de cette clause dans les conditions éventuellement prévues dans le contrat de travail, une convention ou un accord collectif ou, à défaut, avec l’accord préalable du salarié.
En ce qui concerne spécifiquement la contrepartie financière, la jurisprudence a précisé que la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence ne doit pas être dérisoire, sans toutefois fixer un montant minimal légal. Les juges évaluent au cas par cas si l’indemnité est proportionnée aux restrictions imposées au salarié. Dans un arrêt du 16 mai 2012[2], la Cour de cassation a confirmé la nullité d’une clause de non-concurrence prévoyant une contrepartie jugée dérisoire. La cour d’appel avait estimé que les contreparties financières de telles clauses correspondent en général au minimum à 33 % de la rémunération moyenne mensuelle brute sur les 12 derniers mois.
Une contrepartie mensuelle inférieure à 10 % du salaire mensuel a également été jugée dérisoire par les juridictions, entraînant la nullité de la clause[3].
De plus, par un arrêt en date du 15 mars 2023, la Cour de cassation a retenu que, pour que la clause de non-concurrence soit valable, le versement de la contrepartie financière doit être prévu quelle que soit la partie à l’origine de la rupture. Ainsi, la clause qui ne prévoit le versement d’une contrepartie qu’en cas de rupture à l’initiative du salarié est nulle.
En l’espèce, un salarié avait agi en justice pour demander diverses indemnités relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail après son licenciement. Il demandait également le versement d’indemnité au titre de la clause de non-concurrence. Les juges du fond avaient rejeté ses demandes. Ils avaient relevé que le contrat de travail prévoyait le versement de la contrepartie financière en cas de rupture à l’initiative du salarié, ce qui n’était pas le cas puisque le salarié avait été licencié. Le salarié avait formé un pourvoi en cassation pour contester cette décision.
La Cour de cassation a censuré la décision des juges. Elle rappelle que nul ne peut apporter aux droits des personnes et libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. La Cour a retenu que « méconnait la liberté fondamentale du salarié d’exercer une activité professionnelle et, comme telle, est nulle la clause de non-concurrence qui ne prévoit le versement d’une contrepartie pécuniaire qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative
du salarié ».
Consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2023 : https://urls.fr/OcMo0F
[1] Cass. soc., 10 juillet 2002, n°00-45.135
[2] Cass. Soc. 16 mai 2012, n°11-10.760
[3] Cass. soc. 15 novembre 2006, n° 04-46.721
Bien entendu le service juridique de la FESP reste à votre entière disposition pour répondre à toutes vos interrogations et demandes d’accompagnement.
Ensemble nous sommes plus forts!
Le service juridique de la FESP
juridique@fesp.fr accueil@fesp.f